FRANCE
Variable récente

Les suffrages exprimés donnent une majorité écrasante à la gauche. Là est ce que retiendra l'histoire. Le problème est que la somme des abstentions (sans parler des blancs ou nuls) dépasse n'importe quel camp vainqueur ou vaincu, et même la totalité des deux. On remarquera qu'il n'y a pas de hausse concomitante, en quelque sorte compensatoire, des bulletins blancs et nuls. Les régions, très lointaines pour les administrés, n'intéressent pas plus que l'Europe, autre institution tombée du ciel pour les citoyens de base.
La carte de ces abstentions (ci-dessus au premier tour) ressemble terriblement à la zone de force du Front national sur le long terme. L'ancien vote Le Pen, orphelin depuis 2002 de leader prêt à l'exercice du pouvoir, en constitue l'essentiel. Comme le Front national, elle correspond à l'ex-croissant industriel du Nord et de l'Est. Cependant, l'abstentionnisme atteint des sommets dans les banlieues à forte population d'origine étrangère, où le FN a disparu mais où les municipalités concernées ont tablé de gagner de nouveaux électeurs en inscrivant automatiquement les jeunes électeurs sur les listes électorales. En oubliant leur culture de la rue, très éloignée de la démocratie...
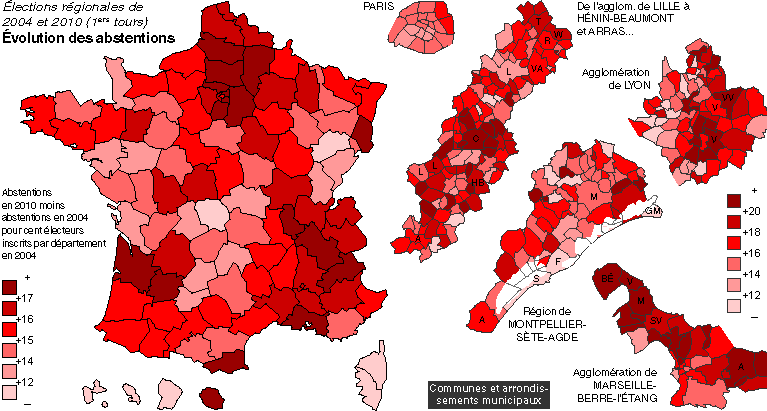
La hausse des abstentions, elle, ne correspond que de loin à celle des baisses du FN. Quel en est donc le complément? Admettons que le manque à gagner frontiste se retrouve exclusivement dans l'abstention (mais la réalité ne doit pas être bien différente, surtout vu la baisse des votes blancs et nuls), on peut alors soustraire aux abstentions nouvelles les pertes FN. La carte ainsi obtenue se rapproche beaucoup, non pas de la carte du MoDem ou de l'UMP (au demeurant très difficiles à cerner vu la présence d'une UDF encore unie en 2004) mais bien de la droite. Pas uniquement toutefois, ce qui signifie que tout le monde a donné, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Pourtant, c'est bien du côté droit de l'échiquier politique qu'on trouve le gros de ces abstentionnistes.
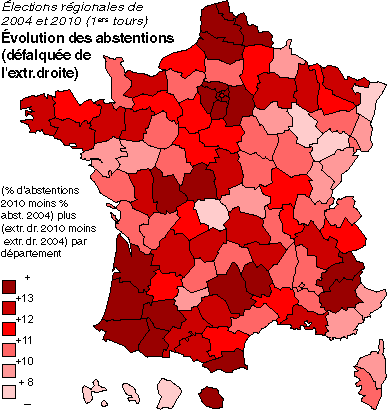
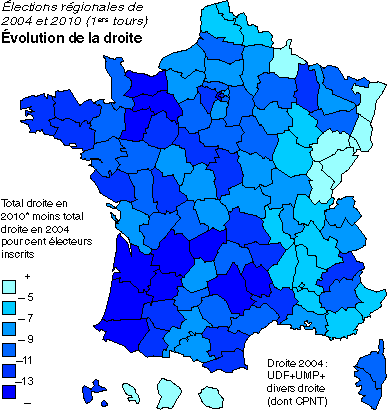
Cet abstentionnisme pèse tellement sur la mécanique explicative que l'évolution des partis ou regroupements politiques de 2004 à 2010 est moins intructive rapportée au exprimés qu'aux inscrits. Retenons cette méthode.
Relativement aux inscrits donc, l'extrême gauche baisse partout, et le détail des cartes montre que la faute n'en revient pas plus à LO qu'à la LCR transmué en NPA. La gauche augmente légèrement dans les anciennes terres démocrates chrétiennes, confirmant ainsi un grignotement continu et observable depuis les années soixante-dix, en Midi-Pyrénées, où elle fait progressivement le vide, mais baisse légèrement partout ailleurs, beaucoup dans des communes symboles des problèmes urbains dans les années quatre-vingt comme Vaulx-en-Velin ou Vénissieux (voir carte détaillée de l'agglomération de Lyon). Les gains numériques de la gauche dans le Languedoc obéissent à une autre règle; nombre d'électeurs de toutes tendances (y compris de droite, dans certains cas incités par quelques responsables élus ayant peur pour leurs crédits d'origine régionale, mais aussi des abstentionnistes de 2004 et des primo électeurs, frondeurs par nature) ont fait un pied de nez aux socialistes officiels autant qu'à la tutelle de moins en moins supportée de la capitale, en votant pour un homme qui a si bien établi un système clientélaire par ailleurs dénoncé par les médias locaux qu'il peut désormais se moquer des pudibonderies langagières et tabous parisiens. Le deuxième tour a déjà fait retomber le soufflet, comme si le premier tour avait été un heureux défouloir. Du coup, le Languedoc se retrouve en creux dans l'évolution généralement positive de la gauche par rapport au premier tour, et même très en creux dans la région de Montpellier... Cela dit, la gauche progresse d'un tour à l'autre sans retrouver ses niveaux départementaux de 2004 (toujours par rapport aux inscrits bien entendu).
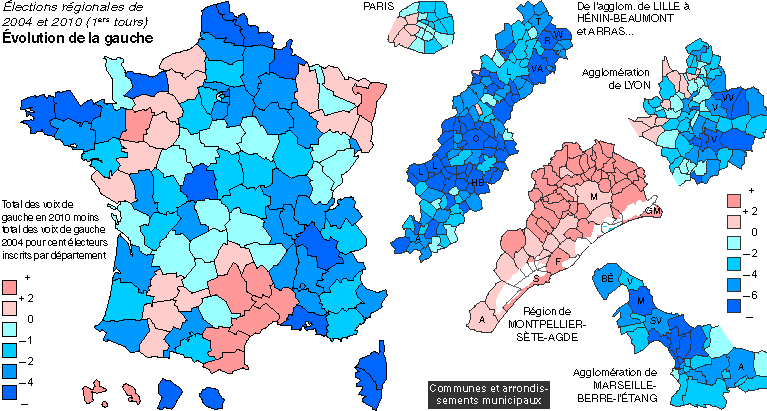
Le MoDem est très faible: il ne conserve quelque force que dans le bastion du chef et quelques votes dans l'Ouest. Malheureusement, on ne peut mesurer et localiser son évolution puisque l'UDF était unie en 2004.
La droite perd partout, mais davantage à l'ouest qu'à l'est. Cette répartition n'a aucun rapport avec l'évolution de la gauche. Autrement dit, la gauche ne triomphe pas en gagnant massivement des voix de droite, mais surtout par abstention de l'adversaire. Il faut donc chercher ailleurs les motifs du plongeon de la droite.
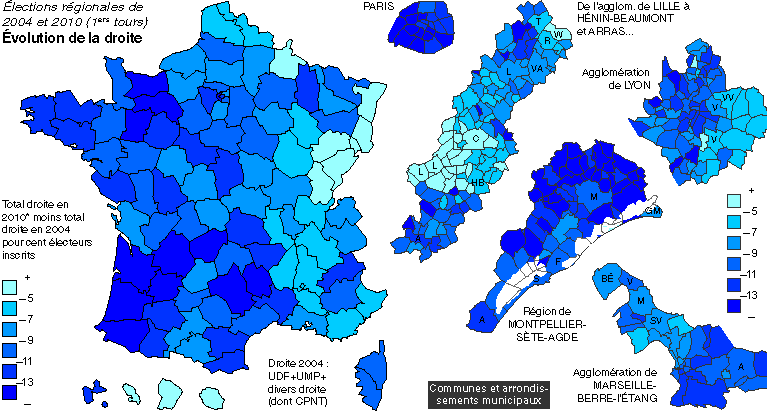
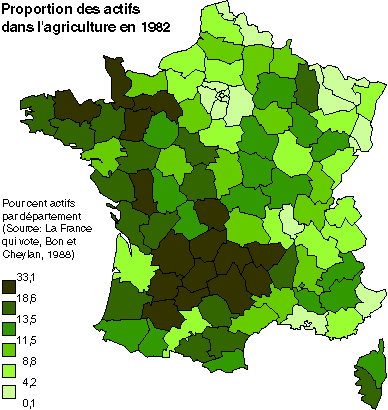
|
Or, son évolution négative rappelle furieusement non pas la répartition géographique actuelle des agriculteurs, trop centrée sur le grand Sud-Ouest, mais celle des années quatre-vingt, couvrant la moitié occidentale du pays et allant de la Basse-Normandie au sud-est du Massif central et aux Pyrénées (carte ci-contre), autrement dit les zones soit à agriculture encore très présente, soit à population agricole à la retraite. Evolution négative de la droite renforcée toutefois dans le centre du Bassin parisien ainsi que dans plusieurs départements de l'ancienne démocratie chrétienne (surtout la Moselle, le Calvados, les Pyrénées-Atlantiques). L'agriculture se meurt, le président lui devient étranger; M. Sarkozy n'a pas de racine dans la France profonde et au fond la méprise, préfèrant tout à la fois le mondialisme, l'atlantisme et l'Europe à marche forcée: elle le lui rend maintenant, faute d'avoir encore assez de troupes pour occuper l'espace médiatique; il représente le monde des affaires et la recherche de la réussite apparente: la France rurale et modeste lui signifie son désintérêt; il plaît aux médias en vantant le métissage et en considérant le pays comme une accumulation d'immigrations successives: la France des produits de terroir, encore en activité ou à la retraite, enracinée et elle sans interrogation sur son identité, perd toute raison de voter pour le parti du Président -- sans trouver ailleurs son bonheur.
Dans cette chute globale, autre chose, de non dit, s'installe dans tous les esprits à droite et concourt à la baisse de l'UMP partout: le président élu parle beaucoup, se déplace souvent, surcharge l'Assemblée de projets de loi, mais aucune de ces lois n'est aboutie, ne va jusqu'au bout de ce qui était attendu en 2007 par ses électeurs; de surcroît, les clauses servant de contrepartie aux mesures gouvernementales sont tellement coûteuses à la nation que même à droite on se demande si cet élu est le bon. Cette pente-là sera difficile à inverser, et ce n'est pas le léger regain du deuxième tour qui peut s'appeler rattrapage: même si la droite progresse davantage que la gauche entre les deux tours, elle est loin de combler le fossé par rapport à 2004. Ni l'inespéré résultat en Alsace, où le succès de la droite semble dû à la fois à une remobilisation des communes rurales, comme partout, et à un vote utile régionaliste et d'extrême droite, pour laquelle d'ailleurs cette région est la seule où celle-ci recule entre les deux tours. Les baisses constatables après le deuxième tour en Bretagne et en Auvergne, notamment dans le Puy-de-Dôme, sont autrement inquiétantes pour la "majorité" présidentielle, tout comme les gains de la gauche en Basse-Normandie, si on se contente de jauger les suffrages exprimés. |
L'extrême droite, enfin, recule sur elle-même, mais moins en Lorraine et dans le Pas-de-Calais pour ce qui est de ses régions de force. Marine Le Pen peut se féliciter de cette halte sinon au déclin du moins à la chute, son père également, proportionnellement aux chiffres de départ. Le plus remarquable réside dans l'effet classiquement appellé "notabiliaire" (déjà!) de la candidate Marine Le Pen dans la région d'Hénin-Beaumont, considérable à Hénin même, net à l'entour, faible ou nul dans le reste de la région. (L'auteur de ces lignes retrouve là une vieille loi de la géographie électorale...)

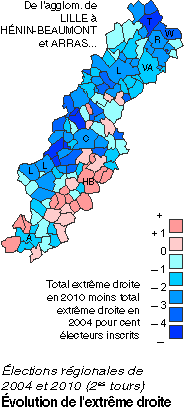
Dans les quatre agglomérations choisies présentement, on observe mieux l'évolution de l'extrême droite. Elle a énormémént reculé au premier tour de 2010 dans les quartiers populaires, beaucoup moins ailleurs. Mais à Marseille (il reste à le vérifier ailleurs en Provence), l'évolution est allée jusqu'à rendre étales les nouvelles positions de l'extrême droite, excepté l'hypercentre de la ville où elle n'existe plus. Son bilan du second tour est différent: baisse sur 2004 malgré un rattrapage partiel du retard dans les quartiers populaires, mais aussi gains bruts, donc progrès réels dans les quartiers typiques de droite par rapport à 2004 (comme dans les environs de Montpellier et de rares communes lyonnaises). Or, la baisse de la droite dans cette ville est symétrique: dramatique dans ses quartiers historiques (est de la ville, sud), faible ailleurs, et faible rattrapage au deuxième tour. Au bout du compte, la ressemblance entre hausse absolue et donc progrès réels de l'extrême droite et baisses accentuées de la droite par communes et par arrondissements de Marseille suggère un transfert direct d'électorat de ce camp-là à ce camp-ci. Ce qui cadre parfaitement au désamour envers le chef de l'Etat, qu'on a retrouvé sur le nom de G. Frêche au premier tour en Languedoc, et qu'on retrouve sans doute au second sur l'extrême droite (très certainement dès le premier tour à Marseille). Cela dit, attention: ce transfert probable est pour l'instant marginal par rapport au stock de voix de chaque grand parti et d'abtentions; il y va d'un ou deux points de pourcentage aux inscrits, le double aux exprimés, exceptionnellement de davantage dans le secteur d'Hénin-Beaumont. Ce qui n'enlève rien à la signification profonde du phénomène... Notons que la gauche, dans les mêmes secteurs, ne progresse nulle part et qu'elle ne prend donc sans doute pas à la droite ce que celle-ci n'arrive pas à regagner.
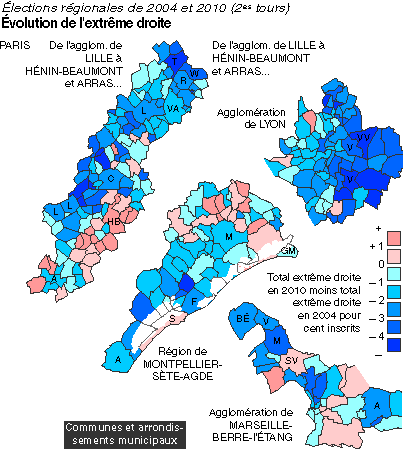
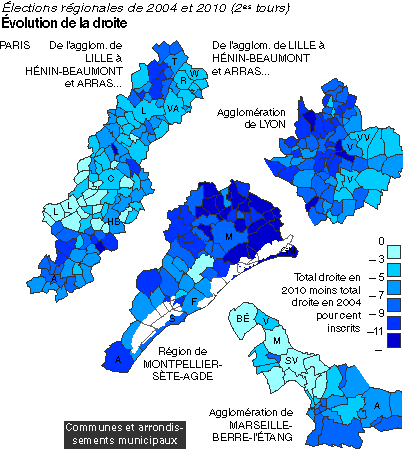
Tous les observateurs étaient obsédés par la référence à l'élection de 2007 et aux européennes de 2009. Dans cet ordre d'idée, la carte la plus révélatrice est celle de l'évolution de la droite globale entre le premier tour de la présidentielle de 2007 et le scrutin du 14 mars 2010. Parce que tout le monde sait désormais que Nicolas Sarkozy, par quelques mots bien placés, avait capté une énorme part de l'électorat le Pen en 2007, on se demandait s'il avait conservé ces suffrages habilement gagnés. La carte de l'évolution sur 2004 laisse pour le moins penser que tout est d'ores et déjà annulé; celle rapportée à 2007 est le calque presque parfait de la moyenne du vote FN depuis qu'il existe, ce qui confirme d'une part qu'il avait bien gagné ces voix à la présidentielle mais aussi qu'il les a bien perdues. A quoi il faut ajouter la Vendée, ce qui signifie que l'électorat de Villiers a littéralement fui le ralliement "technique" de son meneur au président de la République.
Autre remarque: aux élections européennes, le succès de la droite était donc un succès en trompe-l'oeil, obtenu grâce une abstention plutôt du camp adverse additionnée d'une sanction de la gauche classique en pleine querelle de chefs par un vote Vert protestataire, et non par gain de nouveaux électeurs.